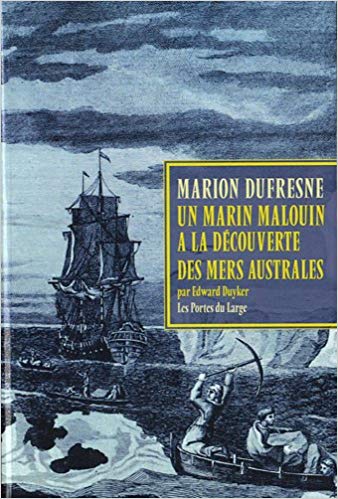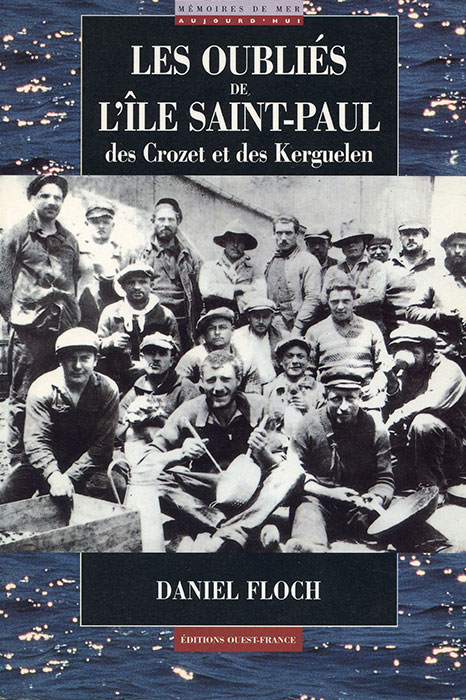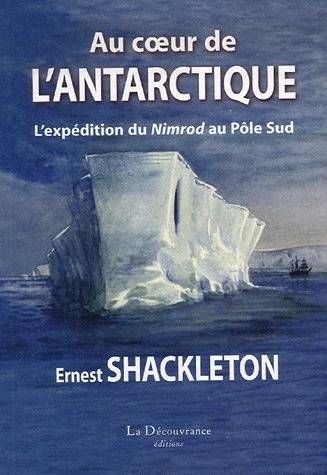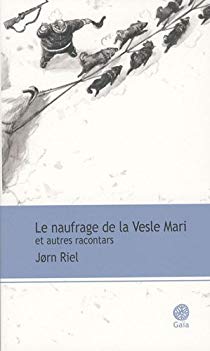LE NAUFRAGE DU « NANCY BELL » SUR LES RIVES DE KERGUELEN

LE NAUFRAGE DU « NANCY BELL » SUR LES RIVES DE KERGUELEN
Description
Les récits des naufragés des XVIIIe et XIXe siècles ont une source commune : la célèbre histoire de Robinson Crusoé, publiée par Daniel Defoe en 1719. Que le naufrage soit authentique, ou fictif, tout, ou presque, est là.
Les imitations ont été innombrables, avec toujours les mêmes thèmes, bien qu’elles soient loin d’avoir la portée philosophique de l’ouvrage de Daniel Defoe. Du moins racontent-elles la même aventure, et qui finit toujours par le sauvetage au moins d’un naufragé : celui qui racontera.
Dans un récent ouvrage, a été publiée l’histoire de la catastrophe arrivée, en 1873, à un bateau d’émigrants anglais allant en Nouvelle-Zélande et se fracassant la nuit sur un rocher des îles Crozet ; cette histoire fut racontée par une survivante anglaise Mrs. Wordsworth, et publiée alors dans une revue britannique très populaire.
Peut-être est-ce cette histoire vraie qui a inspiré à un écrivain anglais prolifique de l’époque, John Conroy Hutcheson, la composition de son roman : The Wreck of the Nancy Bell, or cast away on Kerguelen Land, ouvrage paru à Londres, Glasgow et Dublin en 1885, et plusieurs fois réédité.
Ce roman, qui ne fut guère connu en France (et pour cause : les îles Kerguelen n’étaient pas encore françaises*), est une histoire de mer à l’intention des jeunes gens britanniques destinés à affronter les mers difficiles du Grand Sud. Et, en même temps qu’on y trouve les thèmes de Robinson Crusoe, il comporte des exemples de toutes les vertus victoriennes de l’époque.
Voici l’histoire, toute simple et terrible.
Le Nancy Bell est un bon vieux clipper construit en bois. Un clair matin de juin, il part du port de Plymouth, pour transporter des émigrants à Dunedin en Nouvelle-Zélande.
Parmi eux, un ancien officier de la Royal Navy, M. Meldrum, se révèle très précieux, doué du sens du commandement et de la mer, et ayant avec lui une collection inattendue de cartes marines ; il est accompagné de ses deux filles (qui l’appellent d’un distingué « Papa dear » au lieu de l’habituel et simple « Daddy » ! ).
On trouve aussi un voyageur yankee qui ne jure que par mocassins, serpents et alligators, – une dame autoritaire surnommée « le Major » et son gentil petit garçon, -un matelot norvégien ancien chasseur de baleines, -un cuisinier jamaïcain tout noir surnommé Boule-de-neige, -un charpentier plein de qualités qui fut un des anciens matelots de Mr. Meldrum dans la Royal Navy. Le capitaine en second est un Irlandais. Et il y a aussi un certain stagiaire, un midship charmant de dix-neuf ans, qui plaira beaucoup à Miss Meldrum l’aînée…- tout ce monde arrivant à se comprendre assez bien, malgré des langues et des dialectes divers.
En doublant le cap de Bonne-Espérance, le Nancy Bell est pris dans une terrible tempête, puis dans un cyclone, il perd toute direction, et, pris dans la houle énorme des quarantièmes, il finit par se fracasser sur les écueils de l’île de Kerguelen, exactement devant le cap Saint-Louis (aujourd’hui cap Louis) sur la redoutable côte ouest. C’est le début du mois d’août, en plein hiver austral.
L’équipage se scinde alors en deux groupes ennemis, l’un voulant immédiatement quitter le Nancy Bell qui va manifestement sombrer : mutinerie d’une douzaine d’hommes d’équipage, qui, après avoir presque assassiné le capitaine, s’emparent de la plus grande chaloupe, la chargent avec le maximum de provisions, et mettent la voile comme ils peuvent vers la terre qu’on voit assez proche.
L’autre groupe, qui les regarde avec effroi disparaître dans le brouillard épais et la mer démontée, est alors fermement pris en main par l’ancien commandant de la Royal Navy. Avec la seule petite chaloupe et un radeau de fortune, celui-ci organise l’abandon de l’épave. Et la petite troupe, – émigrants, officiers et équipage, vingt-sept personnes en tout, et un petit chat ! – arrive saine et sauve sur une plage de sable noir, qu’on découvre au sud-est du cap Saint-Louis, et que recouvrent d’épais flocons de neige. Cette plage est à l’entrée d’une sorte de fjord, à peu près à l’abri du vent.
L’idée, fort juste, de M. Meldrum, est d’attendre la saison d’été austral, novembre et décembre, qui verra revenir les chasseurs de baleines : ils peuvent alors espérer être sauvés. D’ici là, – cinq mois – : eh bien ! Ils retrouvent pour leur survie tous les expédients de Robinson Crusoé sur son île déserte, mais cette fois une île au climat subantarctique et non plus tropical.
Car on ne débarque pas en naufragés démunis de tout, comme l’avait été Ulysse sur la plage de Nausicaa. Pas mal de choses sont sauvées de l’épave, qui sont un départ pour une « accumulation du capital » : exactement comme Robinson Crusoé, avec son tabac, ses clous et son fusil tromblon !
D’abord, l’abri : grâce aux planches et aux tonneaux vides récupérés sur le Nancy Bell, une cabane en bois fort ingénieuse est construite, adossée à une paroi de pierre volcanique imperméable. Cet abri est divisé en trois sortes de chambres : l’une, à un bout de la cabane, la plus confortable et sur le sol de laquelle est étendue une toile de voile, est réservée aux dames (elles sont trois) et aux deux enfants ; l’autre, à l’autre bout, est pour les hommes (ils sont vingt-et-un), les hommes d’équipage dormant par terre, et les officiers ainsi que Mr. Meldrum et l’Américain dans des hamacs. Enfin, entre les deux, la salle de séjour, dirions-nous, pour les repas et les occupations journalières. Les lanternes récupérées sur le clipper éclairent l’ensemble. Cette habile construction est baptisée Château-Pingouin.
Après l’abri, la nourriture : l’île n’est pas aussi stérile qu’on pourrait le croire au premier regard. Et M. Meldrum se souvient de ses lectures. Il sait d’après les récits de Cook, par exemple, que Kerguelen produit le fameux chou de Kerguelen antiscorbutique, dont il donne une description parfaite. D’ailleurs, très vite, il en trouve en quantité tout près du campement. En même temps, il se souvient qu’un vaisseau anglais, le Volage, venu installer la mission d’observation du passage de Vénus dix ans auparavant, a lâché des lapins sur l’île, justement pour secourir des naufragés éventuels. Dès le premier jour de chasse, avec trois fusils sauvés du naufrage, on abat une soixantaine de lapins ! Donc, le menu de tous les jours est diététiquement fixé : lapin au chou, qu’on juge égal à un excellent « Irish stew », quoique, avec le temps et la monotonie, on l’appelle plutôt un « gipsy stew » (un ragoût de romanichel). Les lapins en surnombre sont séchés et salés, formant une provision rassurante. Et la bonne santé est générale. Robinson Crusoé, lui, avait semé des graines, et même domestiqué quelques animaux de basse-cour pour sa nourriture !
Ensuite, les vêtements : en tuant quelques manchots, et en en gardant les peaux couvertes de duvet, on arrive à faire d’excellents vêtements sans difficulté, pour les dames comme pour les hommes. Tout le monde connaît l’étonnante silhouette de Robinson Crusoé avec son chapeau pointu fabriqué par lui-même !
Et des matelots astucieux arrivent même à fabriquer un jeu d’échecs, pour occuper les longues heures oisives pendant les fréquentes tempêtes de neige.
Les deux enfants ont la compagnie du petit chat, ce qui rappelle le chat de Robinson Crusoe mangeant assis à sa table avec lui.
Quant à Miss Kate, la fille aînée de M. Meldrum, elle a toujours la ressource de lire à haute voix des passages de la Bible, une petite bible de poche qu’elle a toujours sur elle. Robinson Crusoe aussi ne se promenait pas sans sa bible.
Il se passe des évènements, sur cette île déserte. M. Meldrum, en débarquant sur la plage de sable noir, avait bien vu vers le sud-est, à travers la tempête de neige, un volcan fumant au milieu d’une calotte de glace. Voilà que ce volcan se réveille, frappant les naufragés d’épouvante! Les lecteurs de Robison Crusoe ne peuvent pas en être surpris : celui-ci aussi, avait été terrorisé par un tremblement de la terre sous ses pieds. Nos naufragés sont recouverts d’une neige noire, c’est-à-dire d’une sorte de suie. Mais bien vite Mr. Meldrum les rassure : le volcan ayant craché une fois, ne le fera pas une seconde fois, et il en persuade ses compagnons de malheur.
Le dernier jour de septembre, grand émoi dans tout Château-Pingouin : on voit arriver au loin sur la mer une chaloupe, montée par quelques-uns des mutins qui avaient menacé de tuer tout le monde au moment du naufrage ! La chaloupe n’avait donc pas chaviré dans la mer alors démontée. De cette douzaine d’hommes, il n’y en a plus que six, au dernier degré de l’épuisement. Mais ont-ils encore les mêmes intentions meurtrières ? Cela rappelle l’arrivée de sauvages « étrangers » sur l’île de Robinson Crusoé.
Ils racontent leur histoire. Après avoir échoué loin sur la côte sud-est, (et avoir aperçu, eux aussi, un volcan fumant), ils n’ont pas tardé à se battre entre eux, après avoir gaspillé leurs provisions et surtout bu tout le rhum qu’ils avaient pris. Ils n’ont pas, pour les commander, un chef de la stature de M. Meldrum, et ils ne savent rien faire tout seuls. Aussi, poussés par la faim, allant même jusqu’à ronger leurs chaussures, n’ont-ils pas choisi tout simplement le cannibalisme ? On décide de tirer au sort qui sera mangé, mais l’homme désigné se rebiffe violemment, lorsque, miracle ! le volcan entre en éruption ! Des pierres tombent du ciel et tuent les plus sauvages des mutins, les survivants reprennent la chaloupe, et repartent le long de la côte, à la recherche de l’autre groupe, qu’ils retrouvent.
Cette allusion au cannibalisme ne va pas très loin. Cependant, elle ne peut pas ne pas évoquer les cannibales découverts par Robinson Crusoé sur son île, des hommes à l’état sauvage, dans son esprit une sorte de sous-humanité. D’ailleurs, les déserteurs recueillis par le groupe de M. Meldrum sont soumis à une surveillance étroite, menacés d’expulsion au moindre désordre. Malgré tout, ce sont des mutins.
Fin octobre, M. Meldrum pense à organiser le voyage difficile de toute la troupe (ils sont trente-deux maintenant) vers la côte est de Kerguelen, où il sait, par ses lectures antérieures, que vont arriver les chasseurs baleiniers américains. D’après sa carte, l’île est formée de deux parties, l’ouest et l’est, réunies par un isthme. Eux sont à l’ouest, où la côte est trop dangereuse pour qu’aucun bateau ne passe jamais ; ils doivent aller à l’est, où se rassemblent les chasseurs dans la grande baie du Hillsborough et la baie des Baleiniers, exactement à l’anse Betsy où ils laissent leurs ustensiles d’une année sur l’autre. On adopte donc le système du portage, comme les Indiens d’Amérique, quand on se trouve sur terre, et l’on met la chaloupe à l’eau dès qu’on arrive à la mer libre. Ce système les fait arriver en quatre semaines à l’anse Betsy. Cependant, il est curieux de constater que n’existent, pour l’auteur, ni les chaînes de montagnes, ni les calottes glaciaires, ni les torrents glacés, ni les fondrières, ni surtout le froid, la pluie et le vent.
Enfin à l’anse Betsy, le premier bateau baleinier qui arrive vient de chasser entre Heard et Kerguelen. Il s’appelle Matilda Ann, de New London.
La fin de l’histoire ne fait que deux pages. Le Matilda Ann ramène au Cap tous les rescapés, qui, de là, ou repartent en Angleterre ou continuent leur voyage pour la Nouvelle-Zélande. L’Américain, lui, retourne en Amérique, ayant engagé à son service Boule-de-neige ravi.
Et M. Meldrum promet la main de sa fille aînée au charmant midship, qui repart à Londres suivre les cours pour devenir commandant de navire à son tour, et ensuite aller en Nouvelle-Zélande recevoir le prix de son amour… Heureux naufrage !
D’où vient donc la science de M. Meldrum alias l’auteur J. C. Hutcheson ? D’abord il a lu, – et cela il le dit, – le récit du 3e voyage du capitaine James Cook. Et il est fort probable qu’il connaît bien les chapitres sur Kerguelen de Sir James Clark Ross. En effet, celui-ci y a passé plusieurs semaines en 1840, et son livre a été publié en 1847. Le lieutenant Campbell, sur le Challenger, a publié ses souvenirs en 1876. Mieux, le livre très détaillé du Dr Mc’Cormick, compagnon de J. C. Ross, a été publié en 1884. Hutcheson a très bien pu connaître tout cela.
Cependant, la géographie d’Hutcheson est très défaillante : en effet, de l’extrémité ouest de l’île de l’Ouest (car c’est l’île où auraient abordé les naufragés), il paraît bien impossible de voir les îles Nuageuses à une centaine de kilomètres au nord, ou d’apercevoir le Mont Ross derrière plusieurs chaînes de montagnes. Quant au volcan : on n’a guère de relation qu’il ait produit autre chose que des fumerolles. Hutcheson, qui n’avait à son époque que des cartes d’hydrographie marine, a inventé, et il emploie des noms célèbres depuis longtemps sans savoir à quoi ces toponymes s’appliquent.
D’autre part, il est frappant qu’il n’évoque pas du tout le combustible indispensable pour la cuisine, le chauffage et l’éclairage. Il est vrai que Robinson Crusoé en parle peu lui-même : celui-ci vit sur une île tropicale, et coupe autant de bois qu’il veut. Alors, si Robinson Crusoé n’en parle pas… Mais nous savons, nous, que la graisse des manchots et des éléphants de mer était utilisée par les baleiniers : sans doute Hutcheson ne veut-il pas choquer ses jeunes lecteurs.
Mais il y a un détail dans le livre, en fait le plus important : c’est l’affaire du cannibalisme, heureusement non consommé. Toute l’Angleterre a été émue par la découverte dans le grand nord des restes de l’expédition Franklin, d’après lesquels des soupçons de cannibalisme ont été émis. Et cette histoire n’est pas la seule au XIXe siècle. Beaucoup en ont ri, dont W. S. Gilbert, l’humoriste du Fun (= Le Rire), qui, en 1866, a publié The Yarn of the Nancy Bell, une parodie de la célèbre ballade de Coleridge La chanson du vieux marin. Cette parodie, qui a eu un très grand succès, fut connue de tous les Anglais. En reprenant le ton dramatique du poème de Coleridge, elle raconte que les deux derniers survivants du naufrage d’un certain Nancy Bell sont le narrateur et le cuisinier, qui ont déjà mangé tous les autres. Et c’est par une ruse que le narrateur arrive à jeter dans la marmite le cuisinier, qui avait préparé un excellent bouillon avec de la sauge et du persil ; il le savoure jusqu’au bout pendant une semaine, et alors, ne voit-il pas s’approcher du rivage une voile qui vient le sauver, rendant ainsi son crime complètement vain! Et depuis, le narrateur erre misérablement dans son petit village d’Angleterre, racontant à qui veut l’entendre son horrible forfait et le remords qui le poursuivra jusqu’à la fin de sa vie.
Le livre d’Hutcheson, reprenant le nom déjà bien connu de Nancy Bell pour son clipper, évoque donc un problème que tous les habitués de la marine à voile connaissaient bien : comment survivre après un naufrage sur une île déserte et stérile ? Et il en donne une réponse artificielle mais très morale…en s’appuyant sur l’exemple fameux de Robinson Crusoé !
Gracie Delépine
N.B. Ce livre d’Hutcheson a été assez connu en Angleterre, pour qu’il soit entièrement mis sur Internet, par les soins d’Athelstane E-texts, un éditeur des grands romans classiques anglais du XIXe s. sur le Web.
*NDLR – La prise de possession des îles Kerguelen par la France date du 2 janvier 1893 (Aviso Eure, Cdt Lieutard)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
(roman, par John Conroy Hutcheson, 1885)